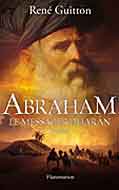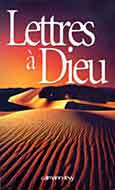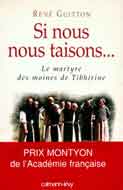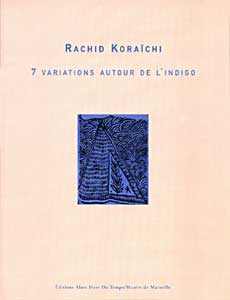Parution janvier 2003
Au premier jour de la couleur, il y eut la lumière. Dieu vit qu’elle était bonne et la sépara de l’obscurité. Puis vint le déluge et à la fin des pluies, quand le tumulte fut apaisé, l’arc-en-ciel de Noé apparut dans le prisme des gouttes en suspens, dessinant la palette...
(Editions Musée de Marseille) Texte de René Guitton, sur des oeuvres de Rachid Koraïchi.
Extrait : La traversée des apparences
Au premier jour de la couleur, il y eu la lumière. Dieu vit qu’elle était bonne et la sépara de l’obscurité. Puis vint le déluge et à la fin des pluies, quand le tumulte fut apaisé, l’arc-en-ciel de Noé apparut dans le prisme des gouttes en suspens, dessinant la palette.
Entre le bleu et le violet s’insinua alors l’indigo.
Indigo infini, traversée des apparences, qui va de la mer au ciel en ce qu’il a de plus pur et mène le regard du palpable à l’invisible. C’est tout à la fois l’horizon, l’espoir, le souvenir, un désir de surnaturel, l’expression du calme et le la paix face à la violence des pourpres et des autres écarlates ; c’est l’achèvement des opacités et des tensions.
L’indigo, c’est la tranquillité de l’âme, la couleur de l’absolu.
L’artiste méditait. Il était venu chercher l’inspiration dans cette cité vieille de plusieurs millénaires. Alep au nord de la Syrie. Comme les couleurs voyagent, il voulait retrouver des traces de bleu sur cette route de l’Inde d’où venait l’indigo. Car en Alep, au fil des siècles, cette teinture avait été l’objet de nombreuses études dont certains secrets furent peu à peu révélés : indigo mêlé d’écorce de grenade avec addition d’eau de dattes ou de suc de raisin noir broyé ou de figues piétinées. Ces macérations étranges conféraient à l’indigo d’Alep une haute réputation dans toute la Méditérranée. Rachid Koraïchi souhaitait aussi acquérir de la soie, chiner de ces tampons anciens que les imprimeurs de tissu utilisaient encore au début du XXe siècle. Il les mêlerait aux siens qu’il allait créer ici, inspiré, comme nulle part ailleurs, par les étoffes imprimées. L’ambassade de France, à Damas, et les responsables des services culturels, sensibles au projet à ce point prometteur, lui accordèrent une aide chaleureuse et il fut hébergé en une demeure, vestige du Mandat français, toute proche de la citadelle. L’artiste allait y travailler en paix et remonter la mémoire de l’indigo et des routes de la soie.
La villa est un havre de silence et de fraîcheur au bout d’une impasse étroite. Un patio reçoit du ciel le chant des mille muezzins de cette ville aux mille mosquées, marquant de la mémoire d’Orient et du Divin, les créations de l’artiste. La chose est d’importance. Toute l’expression de Rachid Koraïchi sert à relier les hommes dans la diversité des peuples, des cultures et de leurs religions, témoignage d’un humanisme profond, harmonie et beauté de la philosophie soufie qu’il porte jusqu’au bout de son art.
Il installa sa table sous une véranda de jasmin, face au jet d’eau, sortit ses encres et ses plumes, affûta ses pointes de roseau pour dessiner, à son tour, les modèles de tampons de bois qu’il allait faire sculpter par des artisans alépins. Il était prêt. 
Le voilà qui trace et peint, hésite et invente des formes qui s’enlacent et s’étreignent. Au bout de ses pinceaux jaillit l’infiniment grand et l’infiniment petit : ce point de vue à partir duquel il regarde le monde, ce point de vue que le spectateur ressent différemment selon la distance depuis laquelle il perçoit les empreintes. Difficile alchimie. Car l’œuvre de Rachid Koraïchi, comme celles des grands peintres, plasticiens, sculpteurs… répond à l’art du voir et du savoir. Jeu des formes et de la culture. Jeu des traces d’une mémoire ancestrale.
Il reprend ses planches de papier, les observe, les scrute puis se recule, en froisse quelques-unes et les jette rageusement. Reprend la plume et travaille ainsi jusqu’à l’heure où il n’est plus possible de distinguer le chien du loup et le bleu du vert, ce moment où le crépuscule vire à l’indigo.
Alors il relit «Les chants de la recluse» de Rabi’a, l’une des fondatrices de la mystique musulmane. On demandait à cette sainte femme : «Celui que tu adores, le vois-tu ? -Si je ne Le voyais pas, je ne pourrais pas L’adorer, répondit-elle.»
Quelques aphorismes encore et il s’endort en paix avec lui-même.
Au petit matin, il se lève, émergeant des effluves de jasmin, dans un état de veille qui va durer jusqu’à l’heure où l’on commence à différencier la nuance des couleurs.
Quand enfin, il parvient à distinguer le fil d’indigo à la lumière de l’aube, c’est que le jour est né, que son esprit est limpide comme le ciel, qu’il va pouvoir peu à peu renouer avec cet état de fusion dans lequel il se replongera jusqu’à la tombée de la nuit.
René Guitton"